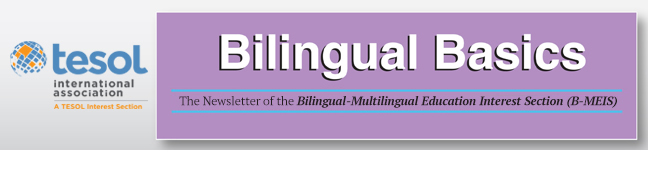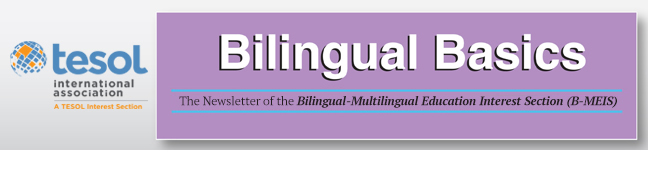Perspectives latino américaines de l'interculturalité
L'objectif de cette étude de cas est de décrire un programme interculturel né en 2006 à la l'Université Populaire Autonome de l'État de Puebla (UPAEP), université privée de la ville de Puebla (Mexique),
appelé « Una apuesta al futuro » (un pari sur le futur). Je dirigeais le Département de Langues et j'enseignais un cours
d'anglais optionnel aux étudiants autochtones inscrits dans ce programme. Le but du Département de Langues était d'aider ces
étudiants à être plus confiants face à leur apprentissage de l'anglais. L'analyse de cet article découle d'observations
personnelles et des maigres résultats obtenus dans les cours d'anglais que nous donnions aux étudiants autochtones de ce programme. Leurs
notes finales étaient en effet bien en dessous de la moyenne et ils disaient être intimidés face à l'anglais car ils se sentaient
inférieurs et avaient peur de commettre des erreurs face aux étudiants du groupe majoritaire. Cet article fait également
référence aux résultats d'une étude réalisée dans cette même université où 300 étudiants de licence
ont démontré posséder une motivation extrinsèque très importante mais une pauvre motivation intrinsèque (Despagne, 2008),
dû aux perceptions négatives envers l'anglais en relation avec les problèmes économiques, politiques et sociaux culturels entre les
États-Unis et le Mexique (Despagne, 2010). Au Mexique, l'anglais est perçu comme étant un pouvoir symbolique (Bourdieu, 1982) qui permet
à ses utilisateurs d'aspirer à un meilleur niveau de vie.
Mais si la motivation extrinsèque est aussi élevée, pourquoi nos étudiants ont-ils autant de problèmes pour apprendre
l'anglais ?
Cet écrit prétend chercher de possibles réponses à cette question en prenant comme point de départ la perspective critique
latino américaine de l'interculturalité (Bonfil Batalla, 1982, 1983, 1988; Mignolo, 2005; Escobar, 2005). Après avoir défini le
concept d'interculturalité, il ébauchera tout d'abord la structure et le pouvoir colonial du savoir avant de s'orienter vers les attitudes
discriminatives qui en émanent. En dernier point, il décriera l'importance de la contextualisation des savoirs dans l'apprentissage,
condition sine qua non pour pouvoir aspirer à une éducation égalitaire.
INTERCULTURALITÉ
Depuis 2003, le Mexique est officiellement une nation multiculturelle où l'espagnol et les 62 langues autochtones sont reconnus comme étant
des langues nationales[1]. La réalité est cependant bien différente. Les politiques
d'assimilation linguistiques imposent l'Espagnol comme étant la seule langue officielle du territoire depuis l'Indépendance, ce qui lui
confère un statut supérieur aux autres langues. Pas grand-chose à changé depuis 2003. Il faut juste ajouter l'Anglais à la
carte linguistique du pays, langue indispensable à savoir si l'on aspire à de meilleurs revenus, à la modernité, et donc
au pouvoir. Arturo Escobar (2005) définit le concept de modernité comme étant un phénomène caractérisé par
la réflexion et la décontextualisation de la vie sociale, ce qui mène à une théorie tout à fait rationnelle. Pour aider
les étudiants minoritaires de la UPAEP à éliminer les barrières psychologiques envers l'apprentissage de l'Anglais et leur
permettre de vivre dans les deux mondes, leur propre monde, et celui du monde « moderne », il est donc indispensable de créer un
curriculum d'Anglais interculturel. L'éducation interculturelle n'est pas seulement le fait de vivre côte à côte, autochtones avec
non autochtones. L'éducation interculturelle cherche plutôt à accepter la diversité de l'être et à comprendre ses
nécessités, ses opinions, ses désirs et ses connaissances du monde à partir d'une conception géopolitique différente
(Mignolo, 2005). L'éducation et les salles de classe représentent de ce fait l'endroit idéal pour modifier la géopolitique du
savoir (référence historique locale du savoir de tout citoyen). Pour changer les perceptions linguistiques et culturelles de la
société mexicaine et créer une double vision du monde, la UPAEP, et en général, le système éducatif national devront
désormais orienter la géopolitique du savoir, et donc la conception des programmes d'étude, vers une conception plus locale. Les cours
d'anglais de la UPAEP sont cependant seulement basés sur des références du monde occidental, les livres de cours utilisés
étant importés des États-Unis.
Structure et pouvoir colonial du savoir
La vision euro-centriste des classes dominantes mexicaines et leur identité avec les formes globales du pouvoir sont le résultat de
l'évolution sociale et historique du pays (Walsh, 2010). Cette identité est par elle-même représentative des relations entre
langues dominantes et dominées et des relations de force entre cultures (Bonfil Batalla, 1996). Ces résultats sont clairement liés
à des projets politiques : colonisation et formation d'une nouvelle nation, tous reliés à l'idée d'unification nationale basée
sur une langue et une culture communes. Ceci a entraîné des processus de déculturation et d'assimilation (Hamers & Blanc, 2000),
dont l'origine peut remonter à la création des codes WE et THEY. La séparation entre WE et THEY a
surtout eu lieu au moment de l'indépendance mexicaine quand le gouvernement au pouvoir était formé de créoles, mélange
d'indigènes et d'Espagnols. Ils luttèrent pour l'indépendance du Mexique en créant une identité unique mexicaine basée
sur une vision euro-centriste tout en y intégrant quelques éléments du passé glorieux des aztèques afin de se séparer
définitivement de l'Espagne (Lopez Arellano, 1983 :50).
Toutes les communautés autochtones devaient donc abandonner leurs propres cultures dans le but d'adopter la nouvelle identité unique
créole (Lopez Arellano, 1983 :50). L'espagnol devint la langue qui unifia le vaste territoire mexicain et, de, ce fait aussi la langue officielle
de l'éducation nationale.
Attitudes envers les langues et cultures
Origines des attitudes
D'après Crystal (1992), les attitudes linguistiques représentent tout simplement ce que les personnes ressentent envers leurs propres langues
ou les langues des autres. Au Mexique, les attitudes linguistiques sont néanmoins largement plus complexes. Elles découlent directement du
contexte social et historique du pays. En Amérique Latine d'ailleurs, la production intellectuelle reste associée au concept de «
civilisation » et de « modernité », au pouvoir de la langue écrite et à la hiérarchie raciale (Walsh, 2010). Escobar
(2005 :26) insiste sur le fait que la modernité croit en l'amélioration et au développement continus, tout en se basant sur une
logique rationnelle, la centralisation et une construction verticale du pouvoir. La « modernité » fait partie du processus colonial qui
fut initié en Europe au XVIIème siècle. De nos jours, elle ne repose plus sur la conquête territoriale mais elle impose ses propres
normes économiques, sociales, culturelles et linguistiques (Mignolo, 2005 :29). En d'autres termes, comme l'explique Mignolo (2005 :29), il n'y a
pas de modernité sans colonialité, c'est-à dire sans colonialisme moderne, un colonialisme qui s'impose par le biais
de forces économiques et sociales, mieux connus sous le terme de « globalisation ». . Les connaissances et les langues autochtones ne
sont donc généralement pas perçues comme étant des productions intellectuelles. Elles sont souvent associées au «
folklore » autochtone ou à des objets d'étude exotiques. Elles sont « archaïques » et non « modernes »
(Mignolo, 2005).
Attitudes discriminatives
Depuis la période coloniale, les politiques d'assimilation mexicaines ont donc favorisé la supériorité de la vision occidentale du
monde, et logiquement, la supériorité d'une langue au détriment des autres. La création d'une position dominante d'abord de
l'Espagnol, et ensuite de l'Anglais, a participé à donner une place hégémonique au savoir occidental. Ceci mène à des
attitudes discriminatives envers les langues et cultures minoritaires. Les blancs occidentaux sont généralement associés comme faisant
partie du monde « civilisé », alors que les autochtones de peau brune sont perçus comme étant des « retardés »
(Oehmichen, 2007). Les étudiants du programme interculturel de la UPAEP ressentent ce racisme tous les jours, dans la rue mais aussi à
l'université, de leurs pairs, des professeurs et des administrateurs. Il est souvent arrivé dans notre département de langues que les
professeurs d'Anglais laissent passer les étudiants autochtones de leurs cours au niveau supérieur, par paternalisme ou par pitié, alors
qu'ils n'avaient pas le niveau requis. Cet exemple montre clairement comment la société mexicaine reproduit, consciemment ou inconsciemment,
l'habitus de Bourdieu (1982), c'est-à dire comment elle reproduit tout un système de dispositions et de prédispositions qui ont
été acquises socialement. Le discours de la culture dominante a, de ce fait, hérité du discours colonial (Pennycook, 1998).
Conditionnement des savoirs
Le néocolonialisme mexicain, c'est-à dire la perpétuation du discours colonial (Pennycook, 1998; Phillipson, 1992, 2008 ; Calvet, 2002),
promeut l'apprentissage de langues internationales « utiles » et perçoit le monde seulement à travers ces mêmes langues. Le
néocolonialisme conditionne de ce fait le savoir, les perceptions et les attitudes, souvent de façon tout à fait inconsciente. La
plupart des attitudes linguistiques sont liées au discours de la culture dominante globale. En tant que professeurs, nous devons favoriser la
discussion critique dans les salles de classe car, du point de vue de la théorie critique, le savoir doit être construit à partir de son
contexte social et de ses contraintes. Il doit être construit là où les apprenants peuvent vraiment s'engager à un changement
social (Benson, 1997 :22). Dans un de mes cours d'anglais avec des étudiants autochtones, nous avons discuté des perceptions du bilinguisme.
Tous parlaient espagnol et nahuatl couramment mais aucun d'entre eux ne s'autodéterminait comme étant bilingue. Pour la majorité des
mexicains, être bilingue, c'est parler espagnol et anglais ou espagnol et français. Seules les langues internationales sont reconnues comme
telles. Le nahuatl n'est pas perçu comme étant une langue à part entière, c'est seulement un « dialecte ». Quand ces
apprenants ont accepté être des personnes bilingues à part entière, ils ont pu utiliser leur bagage linguistique espagnol et
nahuatl pour construire leur apprentissage de l'anglais. Les transferts métacognitifs, métalinguistiques et même certains aspects
pragmatiques sont alors duenus possibles. Tous les étudiants de ce cours ont investi leur identité dans leur apprentissage en créant un
curriculum vidéo en nahuatl et en anglais à l'aide du programme « Optimal Résumé ». Ils pourront désormais envoyer
cette vidéo dans les deux langues à de futurs employeurs et revendiquer leur propre identité.
Repenser l'éducation au Mexique, c'est donc favoriser une pédagogie plus critique dont le but est d'émanciper les étudiants pour
qu'ils puissent devenir des « voiced learners » (apprenants qui ont une voix) (Pennycook, 1997 :50). J'espère ainsi pouvoir aiden nos
étudiants à remettre en question les relations entre l'espagnol, l'anglais et leurs langues natives, ainsi que les discours pour lesquels ces
langues sont utilisées.
L'interculturalité mexicaine : un paradigme
Les politiques linguistiques mexicaines représentent dans ce sens un exemple très clair. Elles sont l'expression du discours colonial
perpétué par le biais des politiques d'assimilation à l'espagnol et à la « modernité » globale (Escobar, 2005). Ou
comme l'exprime si bien Catherine Walsh (2010:83) « While colonialism ended with independence, coloniality is a model of power that continues
» (Bien que le colonialisme ait pris fin avec l'indépendance, la « colonialité » est un modèle de pouvoir toujours
très actuel). De nos jours, ces politiques vivent cependant un paradigme très important. Suite aux révoltes indigènes menées
par le EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional / Armée Zapatiste de Libération Nationale) en 1994, plusieurs réformes
constitutionnelles ont vu le jour (Hamel, 1995, 2001 ; Cuevas, 2004 ; Schmelkes, 2009) et une nouvelle Loi Générale des Droits Linguistiques
pour les Peuples Indigènes a été décrétée en 2003. Aujourd'hui plus que jamais nous pouvons assister à une
aspiration interculturelle qui s'oppose catégoriquement à l'ancienne éducation bilingue mexicaine car elle cherche non seulement à
former les élèves indigènes dans leur langue native, à partir de leurs propres géopolitiques du savoir, mais aussi, à
éveiller les non indigènes quant à la richesse de la diversité culturelle et linguistique du pays. En bref, l'éducation
interculturelle vise la population entière et s'efforce de mettre fin aux pratiques discriminatoires. Elle cherche aussi et surtout a ce que le
monde occidental accepte de pouvoir apprendre à partir des perceptions du monde autochtone. La notion d'éducation interculturelle aspire donc
à harmoniser la vision occidentale « globale » du savoir avec la vision locale, tout en favorisant la participation active des deux
communautés dans la prise de décision et l'élaboration des curricula. Il paraît de ce fait important de ne pas oublier que les
processus d'apprentissage de nos étudiants doivent être contextualisés dans leurs propres références du monde avant
d'introduire des éléments rationaux du monde occidental. Et c'est bien là un des défis les plus importants à relever pour les
cours d'anglais à la uPAEP. L'enseignement doit commencer à partir de la réalité des apprenants et ne doit pas chercher à
assimiler les étudiants minoritaires aux standards occidentaux.
Bibliographie
Benson, P. (1997). The philosophy and politics of learner autonomy. In P. Benson & P. Voller (Eds.), Autonomy & independence in language learning (Applied Linguistics and Language Study edition, pp. 18-34). London and New York: Longman.
Bonfil Batalla, G. (1982). El etnodesarrollo: Sus premisas jurídicas, políticas y de organización. In F. Rojas Aravena (Ed.), América latina: Etnodesarrollo y etnocidio (pp. 133-145). San José Costa Rica: Ediciones FLACSO.
Bonfil Batalla, G. (1983). Lo propio y lo ajeno: Una aproximación al problema del control cultural. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 27, 181-191.
Bonfil Batalla, G. (1988). La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. Anuario Antropológico, 86
, 13-53.
Bonfil Batalla, G. (1996). México profundo: Reclaiming a civilization [México profundo] (Dennis A. Philip Trans., 1st ed.). Austin:
University of Texas Press.
Bourdieu, P. (1982). Language and symbolic power [Ce que parler veut dire] (G. Raymond and M. Adamson, Trans.). (1st ed.). Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Calvet, L. (2002). Le marché aux langues. Les effets linguistiques de la mondialisation. Mesnil-sur-l'Estrée : Editions Plon.
Crystal, D. (1992). An encyclopedic dictionary of language. Angleterre: Oxford Blackwell.
Cuevas Suárez, S. (2004). Ley de derechos lingüísticos en México. Dialogue on Language Diversity, Sustainability and Peace. Conférence présentée au Congrès Linguapax 2004,
Barcelone, Espagne.
Cummins, J. (2001). Negociating identities: Education for empowerment in a diverse society (2nd ed.). Ontario Institute for Studies in
Education (Ed.). Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education.
Despagne, C. (2008).
Représentation que les étudiants de la UPAEP se font de leur processus général d'apprentissage et de leur apprentissage de
l'anglais: Sont-elles propices a l'autonomisation de l'apprentissage de la langue?
(Mémoire non publié). Université du Maine, France.
Despagne, C. (2010). The difficulties of learning English: Perceptions and attitudes in Mexico. Canadian International Education, 39
(2), 55-74.
Escobar, A. (2005). Más allá del tercer mundo: Globalidad imperial, colonialidad global y movimientos sociales anti-globalización. In
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Ed.), Más allá del tercer mundo: Globalización y diferencia (pp. 21-46),
Bogotá: ICANH.
Hamel, R. E. (1995). Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas. Alteridades 5, 11-23.
Hamel, R. E. (2001). Políticas del lenguaje y educación indígena en México. Orientaciones culturales y estrategias pedagógicas
en una época de globalización. Políticas Lingüísticas. Norma e Identidad., Buenos Aires, UBA, 143-170.
Hamers, J. F., & Blanc, M. H. A. (2000). Bilinguality and bilingualism (2nd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press.
López Arrellano, J. (1983). Diglossie et société au Mexique. Anthropologie Et Sociétés 7(3), 41-62.
Mignolo D., W. (2005). The idea of Latin America (1st ed.). Oxford: Blackwell Publishing.
Oehmichen, C. (2007). Violencia en las relaciones interétnicas y racismo en la ciudad de México. Cultura y Representaciones Sociales. Identidades Étnicas, 1(2), 91-117.
Pennycook, A. (1997). Cultural alternatives and autonomy. In P. Benson & P. Voller (Eds.), Autonomy & independence in language learning (Applied Linguistics and Language Study ed., pp. 35-53). London and New York: Longman.
Pennycook, A. (1998). English and the discourses of colonialism. London: Routledge.
Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism continued (Oxford Applied Linguistics edition). Oxford, England: Oxford University Press.
Phillipson, R. (2008). The linguistic imperialism of neoliberal empire. Critical Inquiry in Language Studies 5/1, 1-43.
Schmelkes, S. (2005). La interculturalidad en la educación básica. Encuentro Internacional de Educación Preescolar: Curriculum y Competencia. Mexico City.
Walsh, C. (2010). Shifting the geopolitics of critical knowledge. Decolonial thought and cultural studies "others" in the Andes. In W. D. Mignolo,
& A. Escobar (Eds.), Globalization and the decolonial option (Routledge edition).